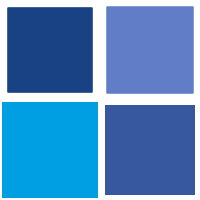Retour aux sources
Depuis l’été 2007, cet éditorial est à l’image de ce que nous avons tous vécu : beaucoup de finance et pas assez d’économie réelle ! Pourtant, le poids de la finance dans le PIB n’a jamais vraiment dépendu directement de la croissance de l’économie réelle. Les grandes périodes d’essor du système financier ont coïncidé le plus souvent avec des bouleversements d’ampleur : chemin de fer à la fin du XIXème, électricité au début du XXème ou internet à la fin de ce même siècle. L’explosion financière de la fin des années 2000 a eu cela d’original qu’elle s’est “auto-nourrie”, créant son propre vent. Aux Etats-Unis, le secteur pesait ainsi plus de 30% des profits totaux des entreprises en 2006/2007 contre une moyenne historique plus proche de 15% depuis la Seconde Guerre mondiale.
Il serait temps que ce secteur retrouve un poids plus en ligne avec son utilité économique… Ce n’est ni de gaieté de cœur ni spontanément que la finance mondiale pourra faire une cure d’amaigrissement : tel un Phénix des temps modernes, elle renaît à peine de ses cendres que déjà les plus enthousiastes se régalent des futures bulles et variations erratiques de prix, sources de profits exceptionnels. En déclarant « we have done God’s job », il est certain que le Président de Goldman Sachs a manqué d’humilité !
Il a plutôt provoqué l’ire d’une autorité peu encline à faire preuve de mansuétude : le Président Obama vient de rappeler fermement à la réalité les “Perrette de la finance” en énonçant les règles qu’il souhaite imposer aux établissements financiers présents sur le territoire américain. Ces règles s’articulent autour de trois axes : taxations nouvelles, limitation de la taille des banques et de leur champ d’intervention. Pour appuyer la force de son propos, Barack Obama est accompagné par l’ancien Président de la Fed, Paul Volcker, l’homme qui a “cassé” l’inflation dans les années 80 et qui évoque spontanément une rigueur salvatrice.
L’agacement devant les propos de quelque Raminagrobis ne doit quand même pas faire oublier que nous vivons ce qui est sans doute la moins mauvaise issue de cette crise. Il y a quelques mois, il fallait avant tout éteindre un incendie, n’accusons donc pas ceux qui l’ont fait d’avoir inondé la moquette ! Le sauvetage de l’épargnant était nécessaire et perçu comme tel là où le sauvetage de la banque d’investissement est dorénavant ressenti comme une charge insupportable imposée au contribuable. Aujourd’hui, ceux qui ont fait appel au peuple remboursent rapidement et l’incendie est éteint.
Alors Oui, il est urgent de mettre en œuvre de nouvelles règles pour éviter (et mieux maîtriser) un éventuel futur incendie. Mais il est aussi urgent de se réjouir d’un équilibre économique mondial retrouvé. A force de ne traiter que les sujets les plus brûlants, on prend le risque de passer à côté de l’essentiel : il est temps que l’argent circule à nouveau sereinement dans notre économie.
Un peu de sérenité et de stabilité ne nuisent pas à notre univers de “stock-pickers”, univers qui, depuis quelques mois, envoie des signaux positifs. Car s’il est une catégorie d’acteurs qui, dans son ensemble, n’a pas failli, c’est bien celle des chefs d’entreprises. Beaucoup plus réactifs que lors des crises précédentes, ils ont maintenu des niveaux de marge plus que décents (6,8% pour le Stoxx 600 en 2009 contre 4,5 en 2003) et en bons barreurs de gros temps, ils ont vite reconstitué la qualité de leurs bilans : un quart des 200 premières entreprises européennes possèdent une trésorerie positive à fin 2009 et abordent 2010 prêtes à faire face à toutes les intempéries.
Après des mois d’éditoriaux de notre Lettre très (trop ?) financiers, gageons que ces chefs d’entreprises profiteront d’un environnement plus favorable et retrouveront dans l’esprit des épargnants une place toujours plus importante, qu’ils n’auraient jamais dû quitter.